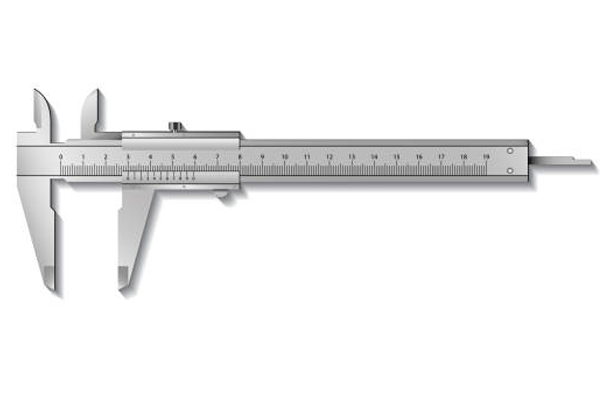Retraites des fonctionnaires d’État : pas de déficit caché mais un coût salarial surévalué. Communiqué de presse
Depuis 2006, les opérations budgétaires relatives aux pensions des fonctionnaires de l’État sont enregistrées dans un compte d’affectation spéciale (CAS) dont le solde cumulé ne peut pas être déficitaire. Il en a résulté une convention comptable où la contribution employeur de l’État est calculée de sorte à équilibrer les comptes. Si cette convention comptable est neutre pour le solde public puisqu’il s’agit de versements au sein des administrations publiques, elle manque toutefois de transparence en mêlant à la fois une cotisation similaire à celle des employeurs dans le régime général, le financement de dispositifs de solidarité (qui ne sont pas couverts par des cotisations dans le régime général, mais pour l’essentiel par des impôts et taxes affectés au nom de la solidarité nationale) et une subvention permettant d’équilibrer le régime, sans qu’il soit possible de distinguer ces trois éléments.
Dans ce Focus, est proposée une estimation des cotisations employeur pour l’État qui approcherait mieux la notion classique d’effort contributif de l’État employeur afin de pouvoir traiter différemment les deux autres éléments qui feraient l’objet d’un transfert du budget général vers le CAS Pensions. Cela conduit à réviser à la baisse le coût salarial des fonctionnaires et augmenter les transferts internes aux administrations. Du fait des règles de consolidation en comptabilité nationale, il en ressort une dépense publique diminuée de 1 point de PIB en 2023 : il ne s’agit pas d’une économie opérée comme « par magie » mais simplement d’un effet de la consolidation qui n’a pas d’impact sur le solde public.
Une convention comptable qui manque de transparence
Le régime de retraite des fonctionnaires de l’État est exposé à un fort déséquilibre démographique (rapport entre actifs cotisants et retraités), nourri par la diminution du nombre de fonctionnaires et à une gestion rigoureuse de la masse salariale publique dont il résulte une assiette de cotisations nettement moins dynamique que celle du secteur privé. Or, ce déséquilibre démographique n’est corrigé que très imparfaitement par le dispositif de compensation démographique entre régimes de retraites. Du fait de l’obligation comptable d’équilibre du CAS Pensions, le taux de contribution employeur, jouant le rôle de subvention d’équilibre a été sensiblement accru : il est désormais de 78,3% pour les pensions civiles et 126,07% pour les pensions militaires.
Dans ce Focus, on propose de distinguer des cotisations employeur pour l’État qui approcheraient mieux la notion classique d’effort contributif de l’État employeur afin de pouvoir traiter différemment les deux autres éléments. Dans cette nouvelle présentation, le CAS pensions obtiendrait in fine les mêmes recettes et cela serait neutre sur le solde public. Mais cela conduirait à diminuer le niveau de la dépense publique (et symétriquement de la recette publique). En effet, au contraire des cotisations à la charge des employeurs qui sont traitées en comptabilité nationale comme étant payées au salarié dans le cadre de sa rémunération, puis payées par le salarié à l’administration, les flux strictement internes aux administrations publiques sont consolidés au niveau toutes APU. Par exemple, la dotation globale de fonctionnement (DGF) des collectivités locales, qui est une dépense pour l’État et une recette pour les collectivités locales, n’est pas incluse dans les dépenses publiques de l’ensemble des APU : cela reviendrait sinon à compter deux fois les dépenses des collectivités locales permises par cet apport de ressources qu’est la DGF.
Une correction qui jette une lumière nouvelle sur les comparaisons internationales
Le taux de cotisation employeur proposé ici est celui évalué par l’Institut des politiques publiques dans une publication récente soit 34,7%, nettement inférieur aux 78,3% et 126,07% que sont les taux de contribution employeurs actuels respectivement pour les fonctionnaires civils et pour les militaires. A titre illustratif la correction proposée conduirait à diminuer les dépenses publiques totales de 28,9 Md€ en 2023 et les recettes publiques du même montant. Il ne s’agit pas d’une économie opérée comme « par magie » sur l’agrégat de dépenses, simplement un effet de la consolidation, qui encore une fois n’a aucun impact sur le calcul du solde public.
Cette mesure corrigée de la dépense publique peut être utile, en particulier lorsque l’on se livre à des comparaisons internationales. Ce sont en effet les domaines de l’État où la masse salariale est la plus importante qui se verraient les plus impactés : en premier lieu l’éducation, (-0,5 point de PIB), la défense (-0,3 point de PIB) et le secteur « ordre et sécurité publics » (-0,2 point de PIB). Cela conduit à modifier le constat tiré de comparaisons internationales :
- Il ressort tout d’abord que les dépenses consacrées à l’éducation (du préélémentaire jusqu’à l’enseignement supérieur) en France seraient inférieures à la moyenne européenne (4,6 versus 4,7 points de PIB) et à celles d’un grand nombre de nos partenaires ;
- Même constat pour ce qui concerne la fonction ‘ordre et sécurité publics’ ;
- En ce qui concerne la défense, même si la France reste au-dessus de la moyenne européenne, la correction apportée jette une lumière nouvelle sur la mesure de notre effort financier dans ce domaine (on passe de 1,8 point de PIB à 1,6 point de PIB en 2023) comparé à une référence parfois avancée de 3 voire 3,5 points de PIB compte tenu du contexte géopolitique actuel.